Marrakech, une cité jardin à sauvegarder
- pierre-andré dupire
- 31 oct. 2016
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 déc. 2019
Pour Mim MAGAZINE by La Mamounia / Marrakech, novembre 2016
Quand les Almoravides s’installèrent au 12ème siècle dans la plaine inhospitalière du Haouz, ils n’imaginaient pas qu’en un siècle, Marrakech deviendrait la capitale d’un empire regroupant tout le Maghreb et l’Andalousie. Quel miracle a pu faire naître une oasis dans une zone semi-aride où les températures peuvent friser 50°C, où il ne pleut pas assez pour maintenir les cultures et où il s’évapore chaque jour la moitié du volume d’eau consommé par l’irrigation, l’alimentation en eau potable et l’industrie réunies ?
Mohamed El Faiz attribue cet essor aux khettaras, des galeries drainantes souterraines permettant d’acheminer l’eau de la nappe phréatique vers l’aval pour y être récupérée, irriguer les surfaces environnantes et alimenter fontaines, hammams, mosquées et riches demeures. 600 galeries drainantes pour 900 kilomètres de long furent construites à Marrakech du 11ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle. C’est grâce à ce témoignage magistral du génie hydraulique de la civilisation arabo-musulmane, que la ville devint la Cité-Jardin qu’elle est toujours aujourd’hui.
Marrakech étonne en effet par sa végétation luxuriante, sa palmeraie et ses jardins. Parmi ceux-ci, ceux de l’Aguedal sont les plus anciens du Maroc et l’exemple même du jardin almohade. Plus de 400 hectares de vergers se juxtaposent autour de bassins où les soldats qui allaient traverser la Méditerranée pour combattre en Andalousie apprenaient à nager. Le jardin de la Ménara s’organise de la même façon autour de son bassin central toujours alimenté par une khettara.
Intra muros, la ville dispose de plusieurs anciens jardins princiers nommés Arsa. L’Arsa Moulay Abdelslam fut donné au Prince Abdelslam par son père, le sultan alaouite Sidi Mohamed Ben Abdellah qui régna sur le Maroc de 1757 à 1790. Rénové par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement, il a rouvert en 2007 sous le nom de Cyber Parc. Offert en dot au Prince Mamoun, frère du Prince Abdelslam, l’Arsa Mamounia fut restauré en 1920 avant d’être intégré à l’hôtel de luxe de la Mamounia. Habitué des lieux, Winston Churchill y passait de longues heures à en peindre les arbres pluri-centenaires.
Au XXème siècle, la ville s’est aussi enrichi d’espaces verts grâce à l’initiative de particuliers, surtout étrangers, nombreux à créer ou à restaurer les jardins de leur propriété dans la médina ou la palmeraie. Les plus illustres sont Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé qui ont fait du jardin Majorelle attenant à leur villa l’un des joyaux de la ville. C’était une palmeraie quand le peintre français Jacques Majorelle l’acquit en 1922. 25 ans plus tard, il l’ouvrit au public après l’avoir planté d’espèces de plantes et surtout de cactées venues du monde entier.
Beaucoup de voix ont défendu cet héritage écologique exceptionnel. Mounia Bennani, Présidente de l’Association des architectes paysagistes du Maroc, a montré que les urbanistes français que le Maréchal Lyautey avait appelés dès 1912 pour concevoir l’aménagement de Marrakech, avaient les premiers posé le principe de zones non constructibles et recommandé qu’on ne fasse pas de lotissements dans la palmeraie.
Hélas, la construction du Guéliz à partir de 1920 et des quartiers ouest de la ville n’a cessé de réduire la surface des espaces verts qui est passée en un siècle de 62 à 2 m2 par habitant, a calculé Mohamed Al Faiz, loin des recommandations des urbanistes. On a fait des efforts de reconquête en créant des kilomètres de promenade arborée le long des avenues de la ville. Cela ne suffit pas. Quant à la Palmeraie, zone écologique de première importance pour la ville à laquelle elle fournit dattes, bois de construction et combustible, et qui abrite de nombreuses cultures maraichères et céréalières, sa superficie a régressé de 30 % en 20 ans. Les équipements touristiques s’y sont multipliés. Ils créent des espaces verts attractifs mais suscitent une spéculation foncière qui a fait reculer l’agriculture. Là encore, la Fondation Mohamed VI a lancé en 2007 un plan de sauvegarde visant la plantation à terme de 430 000 palmiers. Mais cela ne peut suffire.
Car le problème le plus crucial qui menace la ville-jardin, c’est celui de l’eau. L’Agence du bassin hydraulique de Marrakech-Tensift-Al Haouz doit gérer une demande croissante en eau potable mais aussi en eau destinée à l’agriculture, à l’industrie et aux installations touristiques qui constituent un enjeu économique énorme. Le réseau des khettaras est à l’abandon. Même si les golfs sont irrigués par des retenues artificielles, le déficit pluviométrique est tel que le niveau de la nappe phréatique, sur-sollicitée, baisse de façon alarmante malgré les efforts faits pour développer l’irrigation au goutte-à-goutte. La menace est grave pour l’avenir de l’oasis créée par les Almoravides. L’augmentation des coûts de pompage pourrait vite entraîner l’abandon d’exploitations agricoles, et le déficit d’alimentation en eau potable provoquer la désertification des zones rurales. Si rien n’est fait pour une meilleure gestion de la nappe, les conséquences socio-économiques et environnementales pourraient être dramatiques.
Mais il n’est de fatalité qu’à prendre trop tard les bonnes décisions. Une convention réunissant tous les acteurs concernés est en préparation. Souhaitons qu’elle sache gérer au mieux l’héritage écologique laissé par les fondateurs de Marrakech.
Pierre-André Dupire
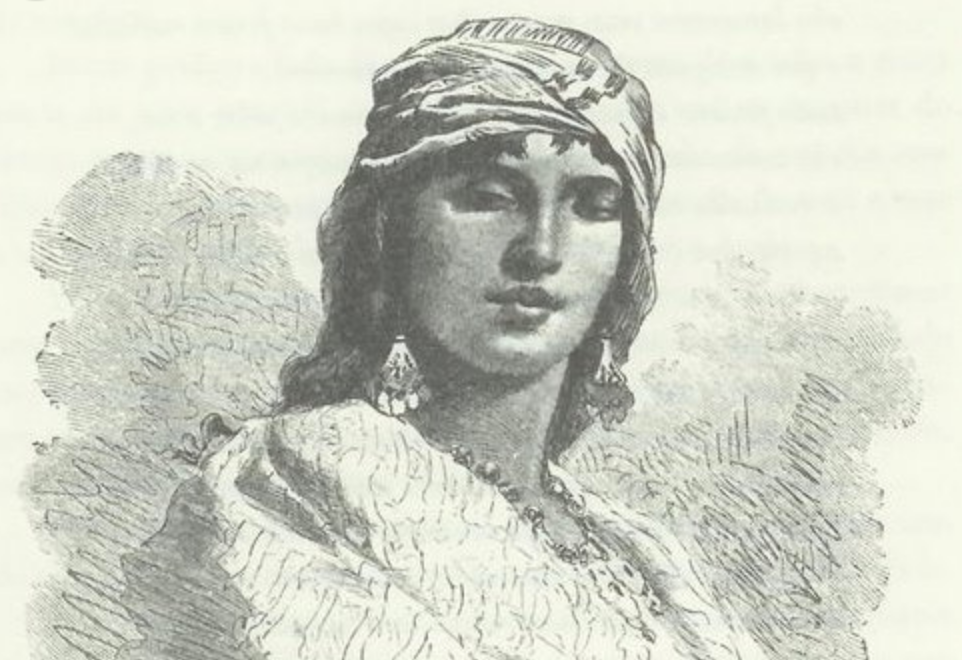

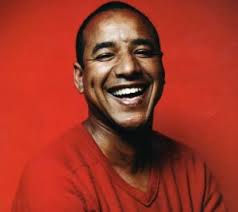
Commentaires